
Les plantes tinctoriales pour les teintures végétales bio.
Il y a fort longtemps, les plantes tinctoriales étaient déjà cultivées par nos ancêtres comme la jacinthe (pourpre), la garance (rouge), le pastel (bleu), les teintures végétales obtenues donnaient des couleurs superbes. Voici une sélection de plantes.
Quelles plantes utiliser pour créer une teinture végétale ?
À peu près toutes, car il n’y a pas vraiment d’impossibilité à obtenir des couleurs à partir de végétaux.
Les racines, les feuilles, l’écorce, le bois des plantes contiennent toujours en plus ou moins forte proportion des substances qui, oxydées à l’air, peuvent former de la matière colorante.
Le rouge d’une fleur ne donnera pas automatiquement une teinture rouge.
Il ne faut surtout pas croire que la teinte d’une fleur ou d’une feuille puisse se fixer ou se reproduire exactement ; ainsi, une magnifique inflorescence rouge vif peut très bien ne donner qu’un médiocre marron verdâtre alors qu’une discrète fleurette blanchâtre fournit un jaune orangé éclatant ou une racine bistre un bleu intense.
Selon la préparation, un même végétal peut donner une infinité de nuances.
Trois modes de préparation différents des plantes tinctoriales :
Infusion
Elle convient surtout pour les parties ligneuses des plantes (racines, écorces, bois) et pour certaines feuilles dures.
Elle consiste à plonger les plantes dans de l’eau froide puis à les faire bouillir à l’air libre plus ou moins longuement.
Il faut ensuite passer le bouillon, qui est d’autant plus colorant que le volume de plantes est important par rapport au volume d’eau.
Décoction
Elle consiste à plonger la plante fraîche ou séchée dans de l’eau préalablement chauffée (ou même, quelquefois, dans de l’eau froide) et à laisser agir quelque temps, de façon que les sucs s’expriment dans la masse de liquide.
Macération
Elle se pratique toujours à froid. On l’emploie pour tous les végétaux dont on veut ramollir les tissus. Par commodité, on la fait souvent précéder de quelques heures de décoction. Les plantes demandent ainsi une plus petite durée d’ébullition.
Des couleurs et des plantes :
Chaque teinte obtenue peut être plus ou moins soutenue selon la durée de préparation : une infusion d’une heure est plus pâle qu’une infusion d’une journée.
Les couleurs peuvent aussi varier selon le mode de culture, la région et la saison de cueillette pour une même espèce de plante tinctoriale.
Rien à voir donc avec les teintures chimiques, la nature est capricieuse, vous obtiendrez donc des couleurs uniques.
C’est au fil du temps et avec du savoir-faire que vous pourrez obtenir la teinte recherchée et la stabiliser.

Plantes pour obtenir le rouge :
Nombreuses sont les plantes tinctoriales pouvant fournir de beaux rouges : du rouge profond et intense de la garance au rose délicat du prunellier, il y a toute une gamme de nuances riches et délicates que vous aurez plaisir à découvrir.
- L’aspérule
Petite plante des sous-bois de hêtres, commune en France, sauf dans le Nord et le Midi.
Sa racine peut être utilisée pour teindre en rouge les lainages.
- Le carthame des teinturiers
C’est une espèce de chardon cultivé, appelé également safran bâtard, dont on peut utiliser aussi la matière colorante contenue dans les sommités fleuries pour teindre en rouge cramoisi (rouge de carthame ou safranum) le lin, le coton, la soie.
C’est la couleur rouge la plus importante après la garance. Un très beau rose s’obtient par infusion.
- Le gaillet jaune
Sa racine teint la laine en rouge assez vif. Ses sommités fleuries la colorent en orangé si on les traite auparavant à l’alun.
- La garance
Plante cultivée depuis très longtemps en France, dans l’Est et le Midi, dont la racine séchée produit en décoction la couleur du même nom.
C’est la source végétale la plus classique de la couleur rouge.
- L’orseille
Cette plante de la famille des lichens, dont il existe une variété océanique et une variété alpine, est souvent utilisée pour teindre la laine en un beau rouge violacé.
On trouve encore assez facilement dans le commerce spécialisé le rouge d’oseille, qui est obtenu en traitant la plante par le lait de chaux puis par une solution alcaline et en laissant l’extrait - résultat de l’opération - pendant quelque temps à l’air.
- Le prunellier
Ses fruits donnent une belle couleur rose qu’on emploie surtout pour les soies et le coton.
Plantes pour obtenir le jaune
Les jaunes sont assez faciles à obtenir à partir de plantes et les nuances sont très nombreuses, depuis les jaunes verts acidulés jusqu’aux orangés chaleureux.
Cette jolie plante aux fleurs d’or, très commune en certaines contrées, donne un beau jaune vif plus ou moins intense selon la concentration obtenue. Ce sont les fleurs seules qu’il faut utiliser.
Sa décoction donne un très beau jaune mordoré ; si vous utilisez des pousses du début du printemps, vous obtiendrez un ton plus olivâtre, jaune bronze.
La fleur de dahlia fournit un bel orange plus ou moins soutenu selon la force des bains.
- L’épine-vinette
Ce sont les baies bien mûres qui fournissent une teinture jaune. Elles sont surtout employées pour les tissus fins, de coton ou de fil.
- Le millepertuis
Les sommités fleuries donnent un jaune d’or remarquable ou, selon la force des bains, des tons cuivrés, des roux, des oranges.
- La reine des prés
Cette plante vivace pousse dans les lieux humides. Ses fleurs contiennent une matière tinctoriale jaune très lumineuse. Il faut les employer assez fraîches.
- Le sumac
Appelé aussi le fustet, cet arbrisseau se caractérise par ses couleurs flamboyantes en automne. La décoction fournit un jaune orange.
L’infusion de bois de sumac traitée à l’alun donne un jaune mordoré ou un fauve verdâtre : si l’on y ajoute un peu de fer, on obtient un très beau vert olive sur la laine, le coton et la soie.
La fleur et les pousses terminales fournissent, avec le fer seul des teintes fauves ou brunes proches de celles obtenues avec le brou de noix. Attention ! il faut employer avec beaucoup de précautions les liquides issus du sumac, car ce sont des poisons violents.
- La fougère grand-aigle
Si vous utilisez au début du printemps les jeunes crosses de fougère, vous obtiendrez un jaune vert délicat.
- La gaude
Appelée encore herbe aux juifs réséda des teinturiers ou jaunâtre, c’est une plante rustique qui produit une matière colorante très solide, jaune tournesol, assez lumineuse. On utilise toute la plante.
Faites sécher gaudes en les retournant fréquemment. La teinture s’obtient ensuite par décoction.
Plantes pour obtenir le bleu
symbole de la sagesse, le bleu est la couleur de nombreuses fleurs, pervenche, myosotis, iris, clématite, mais plus rares sont les plantes tinctoriales donnant cette belle couleur.
- L’indigo
Son pouvoir colorant est considérable. Il provient des feuilles de l’indigotier, plante originaire des régions chaudes et qui fut introduite au XVIII siècle en France et cultivée dans le Midi.
La plante doit être récoltée après floraison et mise à macérer et à fermenter pendant une dizaine d’heures. Il faut ensuite aérer le liquide en le remuant et le laisser décanter.
Égouttez les grumeaux bleus insolubles qui se forment donnez-leur la forme de petits pains et faites-les sécher.
On trouve couramment l’indigo dans le commerce sous forme de poudre. Pour l’utiliser, il est nécessaire de le diluer.
Ces baies donnent un bleu gris plus ou moins soutenu selon la concentration du bain.
- Le prunellier
Ses racines donnent un beau bleu ardoise.
En mélangeant racines et baies, vous obtenez un bleu coloré.
- La paille de sarrasin
La paille de sarrasin doit être humectée pour fermenter. Faites ensuite une pâte qui, séchée rapidement au four, se conserve indéfiniment.
Utilisez cette pâte selon les besoins, en la faisant bouillir dans de l’eau pure. Elle donne un bleu fixe qui, selon la quantité de pâte utilisée, est plus ou moins foncé.
Additionné de poudre de noix de galle, ce bleu change en un très beau vert.
- Le pastel
Aussi appelée isatis ou guède, cette plante pousse dans les terres calcaires du sud de la France.
Ce sont les feuilles de la plante qui contiennent la matière colorante.
Pour l’extraire, il faut d’abord faire flétrir les feuilles et les broyer ensuite à l’aide d’une meule ; vous obtenez une sorte de pâte (d’où le nom de pastel) que vous laissez fermenter une dizaine de jours.
Vous en ferez ensuite des boulettes que vous laisserez sécher à l’ombre.
On le nomme alors pastel « en coques ». Pour l’utiliser, il faut le diluer.
Plantes pour obtenir le noir, le brun et le gris
Alors que les gris, les bruns et les roux s’obtiennent facilement, un beau noir profond est difficile à réaliser. Il faut pour cela mélanger plusieurs concentrés.
Ainsi, vous pouvez teindre en noir le lin et le chanvre en les plongeant dans un mélange composé de brou de noix et d’infusion concentrée d’écorce d’aulne additionnée d’un peu de fer (vous en trouverez sous forme de rouille ou de sulfate de fer vendu dans le commerce sous le nom de vitriol vert).
L’écorce de cet arbre croissant au bord des cours d’eau et dans les lieux humides peut teindre la laine en gris noir.
C’est l’écorce qu’il faut utiliser et de préférence, la récolter au printemps. En concentrant plus ou moins la décoction, vous obtenez du fauve, du roux.
- La noix de galle
Cette excroissance des jeunes feuilles du hêtre utilisée en infusion plus ou moins concentrée permet d’obtenir des gris et des bruns si l’on ajoute un peu de fer ou de sulfate de fer.
L’écorce, les feuilles ou les coques vertes.de fruits (le brou) donnent des bruns très foncés.
Plantes pour obtenir le vert
Ainsi, pour obtenir des teintes vertes, vous pouvez associer le jaune et le bleu, mais il faut d’abord préparer le bain de teinture jaune, y plonger le tissu et, ensuite, le plonger dans le bain de teinture bleue.
Le nombre de plantes fournissant de la teinture jaune et de la teinture bleue étant important, vous pouvez ainsi obtenir tous les tons de verts, du plus tendre au plus vif, du plus jaune au plus bleuté.
sources/Faites tout vous même 1975
Vous aimeriez faire des économies en réalisant de petites constructions au jardin ? Ces pages peuvent vous intéresser.

 Les conseils d'amatxi :
Les conseils d'amatxi :
Par beau temps, si le sol n’est pas gelé, la terre détrempée, plantez arbres et arbustes fruitiers.
Nettoyez les nichoirs installés ou posez de nouveaux nichoirs pour les oiseaux.
Supprimez tous les fruits momifiés au verger.
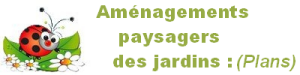

.jpg?v=1j0fh6h)
.jpg?v=1j0fh6h)

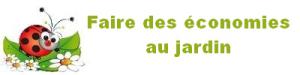



.jpg?v=1j0fh6h)

